28/01/2010
Rossignol chante
Les films de Jane Campion s’enroulent toujours autour d’une figure féminine à travers laquelle elle parle de la sensibilité, de l'éveil au désir, de la volonté de se libérer des carcans (le drame romantique prônant la liberté et le refus des règles s'oppose ainsi à la tragédie classique). Très attachée aux héroïnes romantiques, elle l’est encore avec Bright Star. Dans l’Angleterre des années 1820, elle choisit de mettre en scène la fulgurance de l’amour (chaste) entre le poète désargenté John Keats et Fanny Brawne, jeune fille de bonne famille effrontée qui préfère précéder la mode et briller en société que de s’intéresser à la littérature. Poésie contre couture, âme contre apparence, les premiers échanges sont piquants comme une aiguille, fragile comme un fil. Pourtant, au contact de Keats, Fanny va s'ouvrir aux mystères et aux charmes de la poésie… un nouveau monde qui s’éclaire, une flamme qui ne pourra s’éteindre.
Ce que j’ai tout d’abord apprécié dans Bright Star, c’est de découvrir John Keats, haute figure du romantisme anglais, pourtant peu connu en France. Ses poésies traversent le film comme un courant d’air furtif dont il est difficile de retenir les mouvements. J’ai donc choisi de lire tranquillement certains de ses poèmes et je comprends mieux maintenant l’un de ses vers qui accompagne le film : « A thing of beauty is a joy for EVER ». Keats voue son œuvre à la beauté et au malheur du vivant, à la nature, à l’éphémère… comme sa vie qui l’emporta d’une tuberculose à l'âge de 25 ans.

Pour nous immerger dans cette passion folle et non consommée, Jane Campion choisit le mode de la douceur et de la pureté. Le rythme est lent, l’ambiance feutrée, comme un pied de nez à cette passion courte, à cette vie brève.
En référence à la poésie de Keats, la nature est une allégorie à leur passion. L’évolution de leurs sentiments suit fidèlement le rythme des saisons, comme pour mieux les dévoiler, pétale après pétale, flocon après flocon. Embrassant l'idéal romantique, la nature s'accorde aux émois des amants. C'est dans la nature que le héros romantique trouve généralement une consolation et un réconfort mais c’est cette nature même qui semble participer au tumulte des sens et des sentiments. Hypersensibilité, exaltation, enthousiasme… autant d’émotions qui semblent décupler le rapport sensible à son environnement. Jane Campion filme ainsi un paysage éclatant, dispose une lumière diffuse, charnelle mais vivante et précise, reflétant le contraste entre les débordements de la passion, de la jalousie, et la plénitude du ressenti.
«Je rêve que nous soyons des papillons n’ayant à vivre que trois jours d’été. Avec vous, ces trois jours seraient plus plaisants que cinquante années d’une vie ordinaire.»
A la lecture des mots de Keats, Fanny capture des papillons, comme pour emprisonner le bonheur du printemps et s'enferme avec eux dans sa chambre, les privant d'air et de liberté. «Quand je reçois une lettre, je sais que notre monde est réel, c’est là que je veux vivre » lui répond-elle. Toots, sa petite sœur, débarrasse l’herbe verte d’une feuille morte parce que l’automne n’as pas le droit de venir troubler les sentiments en bourgeons. Au sein de cette nature, le jeune frère et la soeur de Fanny, virevoltent, espionnent et sont le relais pittoresque du spectateur à l'écran. Car au-delà du couple central, délicieux, séduisant, les seconds rôles sont tout aussi captivants, à l’image de la mère chaleureuse qui ne peut lutter contre l’idylle dévastatrice que vit sa fille.
Certains ne seront pas touchés par l’esthétisme perfectionniste (et redondant) de la réalisatrice. D’autres reprocheront à ce film sa lenteur et son rythme répétitif. Mais celui qui n’a pas peur d’affronter son âme d’amoureux y trouvera un écho à des émotions déjà ressenties, indomptables, immaîtrisables, qui bouleversent, car elles entretiennent le désir ambivalent de les revivre autant que de les proscrire à jamais.
 Je ne peux voir quelles fleurs sont à mes pieds,
Je ne peux voir quelles fleurs sont à mes pieds,
Ni quel doux parfum flotte sur les rameaux,
Mais dans l’obscurité embaumée, je devine
Chaque senteur que ce mois printanier offre
À l’herbe, au fourré, aux fruits sauvages ;
À la blanche aubépine, à la pastorale églantine ;
Aux violettes vite fanées sous les feuilles ;
Et à la fille aînée de Mai,
La rose musquée qui annonce, ivre de rosée,
Le murmure des mouches des soirs d’été.
Extrait de Ode à un rossignol, in Les Odes, trad. Alain Suied, Éditions Arfuyen
17:43 Publié dans Les yeux | Commentaires (1)
25/01/2010
I'm the master of my fate, I'm the captain of my soul
Je suis fan de Clint Eatswood et à cela, il n’y a rien à rajouter. Ce que j’aime dans son cinéma, c’est qu’il se positionne toujours à la frontière entre l’intime et l’ouverture, les valeurs individuelles et universelles, la difficulté de l’homme à faire coïncider son quotidien et sa destinée. Et ce qui fonctionne dans son cinéma, c’est qu’il l’incarne sans pudeur; il s’attache à analyser tous les recoins de la nature humaine et à décortiquer une palette de travers, la perversion, la corruption, la perfidie... C’est en puisant une force au plus profond de leurs entrailles que ses héros arrivent toujours à triompher des faiblesses et injustices qui les entourent, Million Dollar baby étant pour moi l'un des meilleurs exemples et l’un de ses plus beaux films. Clint Eastwood, c’est l’apprentissage de la vie mais dans la douleur et la remise en cause.
C’est sans doute pour toutes ces raisons que je lui pardonne quelques erreurs de parcours. Quand Mister Eastwood sort un film, c’est l’évènement et qui se risquerait à écorner le travail de ce monstre sacré ? Ok, mais entre Sur la route de Madison, Un monde parfait, Mystic River ou encore Gran Torino, et L’échange ou le dernier Invictus, je ne pense pas que l’on ait à faire au même réalisateur, se perdant, dans les deux derniers cas, dans un classicisme et un consensus qui font dresser les poils.
Même si je ne m’attendais pas à un grand film, je suis finalement allée voir Invictus parce que traiter de l’Afrique du Sud et du Rugby ne pouvait pas donner un résultat mauvais. Et c’est le cas, c’est un film qui se regarde. Oui, mais c’est un film de Clint Eastwood et je ne retrouve ni sa patte ni son âme.
Invictus est truffé de clichés (les opprimés contre les oppresseurs, le rugby des blancs contre le foot des noirs), Invictus est englué de bons sentiments, Invictus se noie dans le consensus, Invictus est trop maîtrisé, tout autant d’excès qui enlèvent à ce film son âme et dont Eastwood n’est pas le capitaine. D’ailleurs, Morgan Freeman en producteur, c’est un peu se demander si ce film n’est pas un petit cadeau que ce sont rendus deux amis, l’un souhaitant incarner Mandela et tenter la course aux oscars, l’autre voulant s’attirer les honneurs d’un (plus) large public sans prendre de risque… Pendant tout le film, on sent Eastwood en retrait, comme s’il n’était pas aux commandes de son œuvre. Ce n’est pas dans le tout cuit qu’il réussit le mieux.
Invictus est également à côté de la plaque d’un point de vue rythme parce qu’il n’y en a pas vraiment. J’ai mis 30 minutes à entrer dans la course et les scènes de rugby ne sauvent rien, elles s’étirent comme le reste du film, se répètent ; Eastwood martèle le sujet comme pour mieux le faire passer (faute à un scénario assez léger), comme s’il n’était pas accessible à tous alors que c’est sans doute le plus simple qu’il n’ait jamais traité.
Quand on connait à l’avance la fin du film, on attend d’être surpris et chavirés, que Clint nous embarque comme il sait si bien le faire dans les méandres de l’humain. Ici, tout est maîtrisé, l’émotion, le mouvement, les postures… tout est trop propre, trop attendu… au bout d’un moment, ça ne passe plus et le parti pris d’une image aux couleurs à peine appuyées, comme une poussière de savane africaine, nous laisse un peu à l’extérieur de ce qui se joue derrière l’écran. Même les grands mouvements de caméra ou le bruitage viril et musclé lors du match de finale ne parviennent pas vraiment à nous faire vivre les choses de l’intérieur.
Finalement dans la salle, ça fonctionne ; les spectateurs applaudissent au générique (ils me gâchent le plaisir de la musique qui, même aussi mièvre que le film, a su flatter mes oreilles), je n’en reviens pas ! Eastwood, dans la répétition basique du message portant la réunification du peuple sud-africain, nous prend un peu pour des têtes creuses mais personne ne lui en veut.
Oui, mais l’union fait la force, ça on ne peut pas lui l’enlever !!
16:17 Publié dans Les yeux | Commentaires (0) | Tags : clint eatswood, invictus
17/01/2010
Apprendre à finir
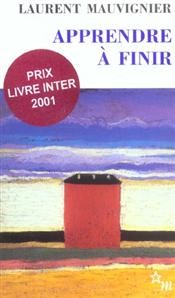 Parce que la vie nous amène tous, un jour, à être confrontés à cette difficulté de « passer à autre chose », j’ai relu il y a quelques semaines ce livre de Laurent Mauvignier, avec l’espoir de trouver un horizon à travers son titre prometteur et 'éducatif' même si je savais qu'il nous emmène sur un autre chemin, celui du renoncement, parce qu’aucune règle, aucune leçon, ne prépare à cette issue fatale. « On ne sait pas ce que ça a de force, tout ce qui fait mal »
Parce que la vie nous amène tous, un jour, à être confrontés à cette difficulté de « passer à autre chose », j’ai relu il y a quelques semaines ce livre de Laurent Mauvignier, avec l’espoir de trouver un horizon à travers son titre prometteur et 'éducatif' même si je savais qu'il nous emmène sur un autre chemin, celui du renoncement, parce qu’aucune règle, aucune leçon, ne prépare à cette issue fatale. « On ne sait pas ce que ça a de force, tout ce qui fait mal »
Le roman de Laurent Mauvignier est entièrement constitué par le monologue intérieur d'une femme, dont le mari rentre de l'hôpital après un grave accident. II va être immobilisé au foyer et sa femme va prendre soin de lui de manière inconditionnelle. Son dévouement et sa douceur sont censés prouver la force de son amour mais ils vont surtout lui permettent de masquer la perspective de sa souffrance à venir. En effet, l’accompagnement à la convalescence ne constituera pas un répit mais un révélateur du processus de désagrégation du couple, annoncé avant l'accident par l’infidélité du mari. “ On ne sait pas avec qui on vit ”.
Ce serait le vide sans lui... alors, elle préfère taire sa douleur, étouffer son humiliation, oublier le dégoût. Quand l'espoir n'est plus, on pourrait croire que ne subsistent que la rancœur et la haine. Mais non, au-delà de la souffrance, elle reste avec l’amour de et pour cet homme. Ce respect pour cet indicible, ce qui la dépasse et qui lui échappe. Quelque chose qui a été et n’est plus mais qui restera. « J'avais cette boulimie qu'on a, à vouloir tout donner parce qu'on se dit ce ne sera jamais assez à côté de ce qu'on a reçu ».
Ce livre est celui d’une femme digne et amoureuse, fragile et rageuse. L’auteur nous embarque dans le souffle de ses peines grâce à une écriture fleuve, ponctuée, rythmée…, où les mots les plus simples deviennent chair et empruntent aux entrailles leur profondeur.
Ce livre restitue toute la schizophrénie qu'implique la douleur de toute rupture, quand on veut encore ce que l'autre ne peut ou ne veut plus. Essayer de vivre avec ce déchirement mais vouloir encore et toujours comprendre, énoncer les responsabilités, colorer d’un peu de raison le tableau noir des sentiments perdus, s'expliquer et expliquer... parce que ne pas savoir, c’est comme perdre l’usage de la parole et ne plus parler, c'est devenir fou. C'est l'esprit qui hurle alors on habille sa douleur de mots qui ne font que la ressasser. La séparation est une autre forme de deuil, à la fois plus douce puisque l'être aimé est vivant mais parfois plus cruelle puisqu’il est encore là… et dont on se libère (parfois) avec le temps.
“ Comme s'il regardait ça sans y être. Qu'il voyait tout ça de loin parce que pour lui c'était fini et que ça ne l'intéressait pas, ou plus, ou vaguement, de loin, en retrait, presque avec étonnement des fois, alors que j'aurais tout donné, tout fait, tout vendu, tout dit, tout, pour qu'un moment je puisse comprendre un petit peu, presque rien, juste pour avoir dans la main des miettes de ce qu'il ne disait pas, pour l'aider, pour qu'il ne soit pas seul à ressasser tout ça, à chercher à savoir pourquoi ou comment on en est arrivé là, à essayer de continuer quand même...”
16:00 Publié dans Les yeux | Commentaires (0) | Tags : laurent mauvignier

